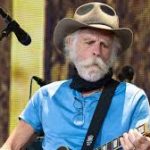L’université Salah Boubnider (Constantine 3) a abrité, dimanche, un colloque national intitulé « Les parcours thérapeutiques durant la guerre de libération : de la médecine traditionnelle au système de santé intégré », organisé à l’occasion de la commémoration du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er novembre 1954, avec la participation d’enseignants-chercheurs, d’historiens et de témoins de la lutte de libération nationale.
Cette rencontre scientifique, initiée par la direction des moudjahidine et des ayants droit en partenariat avec la section de Constantine de la fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche (FOREM) et l’université Constantine 3, a constitué une occasion pour mettre en lumière les efforts humanitaires et médicaux qui ont accompagné la lutte armée, ainsi que pour valoriser la dimension sanitaire qui a contribué à la résilience de l’Armée de libération nationale et des moudjahidine sur les différents fronts.
Dans une communication intitulée « La prise en charge des amputations durant la Révolution », le Pr.
Zohir Boualchaïr, enseignant à la faculté de médecine de l’université Constantine 3, a mis en exergue le rôle essentiel des médecins et infirmiers algériens qui ont consenti d’énormes sacrifices dans des conditions extrêmement difficiles, recourant à des moyens limités et à des remèdes traditionnels pour soigner les blessés dans les maquis et les zones reculées.
Il a souligné que ces pratiques ont jeté les bases d’un système de santé de terrain intégré, qui a constitué le noyau du secteur sanitaire algérien après l’indépendance. Il a également précisé que l’organisation sanitaire révolutionnaire reposait sur les principes de la prévention, du traitement et de l’éducation sanitaire, ce qui a permis de faire face aux épidémies et blessures malgré le blocus colonial.
Selon lui, cette expérience unique « représente une véritable école de médecine de terrain » méritant étude et valorisation scientifique.
Pour sa part, le Pr. Nacer Gerrar, enseignant à l’université Ferhat Abbas de Sétif, a abordé, dans sa communication intitulée « La phytothérapie durant la guerre de libération », l’importance de la médecine traditionnelle et complémentaire dans le soutien des efforts thérapeutiques pendant la Révolution.
Il a indiqué que le recours aux plantes médicinales et aux remèdes traditionnels n’était pas seulement une alternative, mais une solution efficace imposée par le manque de médicaments et les conditions de guerre. Ce savoir empirique, a-t-il ajouté, a permis de sauver de nombreuses vies grâce à la collaboration entre praticiens traditionnels, médecins et infirmiers.
Les participants ont également mis en relief le rôle prépondérant des femmes algériennes dans le domaine des soins durant la guerre de libération, soulignant que les moudjahidate et infirmières ont assuré la prise en charge des blessés, la préparation des remèdes et des pansements, ainsi que l’organisation du transport des blessés et leur accompagnement psychologique.
Les interventions ont rappelé que la femme algérienne constituait « le pilier humain de la santé révolutionnaire », alliant courage, dévouement et abnégation au service des combattants, malgré les dangers permanents auxquels elle faisait face.
Le colloque a également été marqué par la présentation de précieux témoignages d’anciens moudjahidine et d’enfants de chouhada ayant connu les « hôpitaux de la Révolution » dans différentes régions.
Ces récits ont mis en lumière l’engagement des femmes dans le domaine des soins et leur contribution essentielle à la lutte pour la liberté et l’indépendance. En clôture des travaux, les participants ont recommandé la collecte et la préservation des témoignages des médecins, infirmiers et moudjahidine ayant vécu cette expérience sanitaire révolutionnaire.
Ils ont également préconisé la création d’un fonds d’archives national dédié à la médecine durant la Révolution, ainsi que l’intégration de cette thématique dans les programmes universitaires et de recherche.
Ces mesures visent à sauvegarder cet héritage scientifique et humain, un reflet du profond engagement national et de la solidarité du peuple algérien dans sa quête de liberté et d’indépendance.