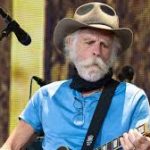Dans un monde où la technologie redéfinit les frontières de la médecine, l’Algérie s’impose aujourd’hui comme un acteur ambitieux et créatif dans le domaine du dépistage précoce du cancer du sein.
Des chercheurs et jeunes innovateurs algériens, animés par une même volonté de sauver des vies, développent des solutions d’intelligence artificielle (IA) capables de transformer radicalement la prise en charge de cette maladie qui demeure l’une des plus répandues au monde.
Parmi les initiatives les plus marquantes figurent celle menée par Fatiha Alim Ferhat, chercheuse au Centre de Développement des Technologies Avancées (CDTA).
Son équipe a conçu un programme intelligent capable de détecter les variations microscopiques des tissus mammaires, révélant ainsi la présence de tumeurs à un stade très précoce.
Alimenté par une base de données médicale riche et constamment actualisée, cet outil offre une précision de diagnostic remarquable « Cet outil permet un diagnostic rapide et fiable, facilitant la prise de décision médicale et renforçant l’efficacité du dépistage régulier », explique la chercheuse.
Ce projet s’inscrit dans une vision moderne de la santé : une médecine prédictive, préventive et accessible, où la technologie soutient le regard humain sans jamais le remplacer.
Un autre projet prometteur émane d’Ahmed Ilyes Bensalem, étudiant à l’École Supérieure d’ Informatique de Sidi Bel-Abbès.
Spécialisé en IA médicale, ce jeune lauréat du Prix du Président de la République de l’étudiant innovant a mis au point un système d’analyse automatisée des biopsies.
Sa technologie permet de réduire considérablement les délais de diagnostic, passant de plusieurs semaines à quelques heures seulement.
« Les tests effectués démontrent une efficacité atteignant 94 %, offrant ainsi aux praticiens un outil d’aide à la décision d’une performance inédite », précise-t-il. Son programme ne se limite pas à l’analyse : il prédit également les chances de réussite d’une intervention chirurgicale, permettant ainsi d’orienter les choix thérapeutiques et d’éviter les complications post-opératoires.
Une avancée majeure, à la croisée de la science, de la précision et de la compassion.
La troisième innovation porte la signature de Romaissa Kaalaf, diplômée de l’Université Mohamed Khider de Biskra et détentrice du Label de projet innovant.
Son initiative, baptisée « Smart Pink », est une plateforme numérique interactive combinant technologie, accompagnement psychologique et sensibilisation.
Elle offre aux utilisatrices un premier outil de dépistage intelligent, tout en créant un espace communautaire où patientes, bénévoles et associations peuvent échanger, s’entraider et accéder à des informations fiables. Grâce à une application mobile intégrée, les usagères peuvent télécharger leurs radiographies et en recevoir l’analyse via l’IA, dans le respect total de la confidentialité. La plateforme propose également un service de suivi des rendez-vous médicaux et des contrôles périodiques.
Mais Romaissa ne compte pas s’arrêter là : elle ambitionne déjà de concevoir une brassière intelligente dotée de capteurs thermiques capables de détecter les premiers signes suspects de la maladie, faisant de la prévention un geste du quotidien.
Ces trois parcours, à la fois scientifiques et profondément humains, traduisent une réalité éclatante : la jeunesse algérienne est en train de réinventer la médecine du futur.
En mettant l’intelligence artificielle au service de la santé, ces chercheurs prouvent que la science peut être porteuse d’espérance, d’humanité et de solidarité.
Leurs projets ne sont pas seulement des prouesses technologiques ; ils incarnent une nouvelle philosophie de la médecine, où la donnée devient une alliée de la vie, et où chaque algorithme est une promesse d’avenir.
Dans un pays où la recherche avance avec détermination, ces jeunes esprits montrent que l’innovation, quand elle est guidée par la compassion, devient une promesse de vie « une lumière pour celles et ceux qui affrontent l’épreuve du cancer, et un signe fort de l’éveil scientifique et humaniste de l’Algérie contemporaine ».
R.N.